- vue le 7 avril au Petit-Palais
Visitée une semaine après l’exposition Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton, « Le Paris de la modernité » fait un peu l’effet d’une douche froide. C’est une exposition importante, qui rassemble beaucoup d’œuvres, d’objets, de véhicules et d’habits du début du XXe siècle. Les commissaires tentent de nous offrir un panorama assez ambitieux de l’époque. Malheureusement, l’exposition pèche par sa muséographie défaillante face au public abondant, son regard un peu idéalisant sur la période et ses œuvres peu excitantes – en ce qui me concerne, du moins. À la décharge de l’exposition, mon exaspération face aux autres visiteurs n’a peut-être pas aidé.
Du plaisir de visiter une exposition aujourd’hui
Non Madame, personne n’en a rien à faire de si vous avez regardé The Crown avec ou sans les sous-titres. Votre mari n’a pas besoin de traverser la salle pour venir le confirmer.
Non Madame, peu m’importe de si Dominique, marraine du petit Baptiste, est très au fait de l’actualité et apparaît régulièrement à la télévision. Par pitié, si vous voulez bavarder à voix haute, allez au café, pas au musée.
Oui Madame, ce serait mieux d’éviter de reprendre quinze fois l’œuvre en photo, de passer devant tout le monde, de faire attendre les autres visiteurs, particulièrement quand il y a des personnes en fauteuils roulants dans des couloirs trop petits.
Et ne vous sentez pas obligé.e.s de commenter chaque œuvre, comme si vous aviez besoin de justifier votre présence dans l’exposition. Je ne compte plus les :
- Ah oui, c’est incroyable. Vraiment fantastique.
- Ah oui, c’est joli ça, j’aime bien les couleurs.
- Ah oui, c’est inspiré de Picasso ça, non ?
- Ah non, ça j’aime pas.
Par pitié, pensez ce que vous voulez des œuvres, mais pensez le. Tout cela avant de prendre une photo et de repartir immédiatement. Mention spéciale, quand même, aux vieux types qui se sentent obligés d’expliquer chaque œuvre à leurs compagnes d’une voix virile et caverneuse dans chaque exposition à laquelle je me rends.
J’en viens à me demander si ceux qui conçoivent la muséographie des expositions ne devraient pas prendre en compte, aujourd’hui, la propension des visiteurs à être impolis, à ne pas faire attention à leur entourage, et à prendre des photos à tout-va. D’où l’importance d’avoir de larges espaces de circulation.
En ce qui concerne l’expo en elle-même
Du côté pratique : l’exposition était mal conçue pour les personnes à mobilité réduite, avec souvent peu d’espace entre les œuvres, et des podiums en plein milieu de la salle qui encombraient l’espace.
Le parcours est assez naturel et logique, sans détours inutiles, ce qui est louable. Ce n’était pas le cas de l’exposition Alaïa, par exemple. En revanche, pourquoi mettre des écrans très lumineux dans ces petites salles, à quelques mètres seulement des tableaux ? Les reflets venaient ensuite perturber le bon visionnage des œuvres.
Sur le fond, je ne comprends toujours pas pourquoi dans une exposition destinée à un large public, on ne rappelle pas le contexte des œuvres. Il me paraît nécessaire, aujourd’hui, d’expliquer la façon dont Picasso peignait ses portraits : c’est-à-dire systématiquement en agressant et en objectifiant les femmes. À ce propos, je vous renvoie à l’excellent podcast Vénus s’épilait elle la chatte, comme d’habitude. Il faut évidemment exposer Picasso, mais il faut aussi en finir avec cette manie d’en faire une idole.
Il y avait de jolis portraits de Modigliani et Van Dongen, des nus de Foujita. De très grandes toiles, assez intéressantes, des fascistes du mouvement futuriste. Un ou deux Laurencin. Rien de fabuleux. Même l’avion, placé au milieu du parcours, laisse sur sa faim. On ne le voit pas bien, il est écrasé dans une salle trop petite.
L’expo souffre en fait d’un trop-plein d’œuvres dans un trop petit espace. On voit beaucoup, on retient peu. Il n’y a pas d’acmé, pas de moment vraiment mémorable à la visite. La rencontre entre la mode, la mécanique, la peinture, la sculpture et la musique retransmet bien une vision assez pittoresque de l’époque. Mais on n’a pas l’impression de vraiment entrer dans les problématiques du temps. On ne peut pas pénétrer l’univers des artistes.
Je ressors finalement avec un début de migraine de l’exposition, sans avoir l’impression d’avoir pu vraiment profiter des œuvres. Je peux cependant recommander la visite à ceux qui auraient deux heures à tuer, en semaine, et qui seraient assez riches pour mettre quinze euros dans une telle expérience.
Cela pose question sur les moyens dont disposent les musées de la Ville de Paris, qui n’ont évidemment pas les mêmes moyens que la Fondation Louis Vuitton. Cette exposition, avec plus d’argent, plus de places, aurait-elle pu satisfaire le visiteur aigri que je suis ?

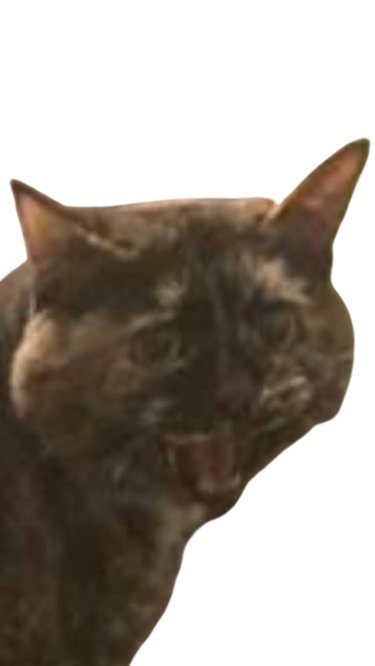
Laisser un commentaire