- vu le 18 septembre 2024 à la Philharmonie de Paris.
J’ai passé un certain temps, étant petit, dans les environs des orgues et des pierres lisses des églises. Monteverdi, au même titre que Gesualdo, Haendel ou Couperin, mes parents les ont chantés. Je les ai côtoyés à distance, en somnolant sur les chaises à l’assise de paille des églises – ou, plus tard, de l’autre côté du mur de ma chambre lorsqu’on répétait à la maison. Je reconnais ainsi leurs motifs, leurs airs, comme on reconnaît un visage oublié ressurgissant du passé.
Il a fallu bien vingt-trois ans pour que je regarde Monteverdi en face : c’est chose faite. Je ne m’attendais pas à un tel spectacle ! Pas de costumes, certes, mais une mise en scène, oui : celle-ci semble induite par la musique, par son aspect « hétéroclite », protéiforme. Les Vêpres sont une véritable pièce organique, qui respire, change de formation à plusieurs reprises, fait dialoguer solistes et chœurs, récitatifs et airs de façon ingénieuse et surtout surprenante. Il n’y avait plus qu’à ajouter les lumières et à régler les mouvements scéniques.
Raphaël Pichon et son ensemble s’en tirent à très bon compte. Ils investissent avec brio l’espace complexe de la Philharmonie pour transporter le public et révéler tout le spectaculaire inhérent à Monteverdi. Pichon le dit lui-même : les Vêpres sont pour lui « la première œuvre cinématographique de la musique ». Et c’est vrai : ces fusées de sacqueboutes enflammées, ces tresses des théorbes autour des cadences titanesques – à plusieurs moments, on se croirait dans Le Seigneur des Anneaux.
À commencer par le début. Noir dans la salle. Un solo a cappella éclot au sein du public, au milieu du second balcon, tel un appel du muezzin. Éclairé par une simple douche de lumière, le chanteur est une luciole dans l’épaisseur de la nuit. Et soudain, lumières : le chœur explose comme un feu d’artifices. J’en ai lâché une larme : c’était épique !
Mais au fil du concert, les chanteurs (et les théorbistes) ne cessent de mettre à profit l’espace pour accentuer les tensions et le drame. Phrases qui commencent sur scène et se terminent dans les balcons, établissant ainsi un dialogue entre deux solistes à trente mètres de distance. Soliste qui se place tout au bout du deuxième balcon-falaise, comme au bord d’une jetée, implorant la Vierge dans un implacable silence, accompagnée d’un simple accord continu. Orgue sous-marin, qui chuchote pour accompagner l’air ténor circulant comme un ruisseau dans la salle. Chœur qui chante depuis les coulisses, comme si les voix nous parvenaient de l’au-delà…
Le jeu des lumières, bien que peu subtil, suit les grands mouvements scénographiques en leur créant l’atmosphère appropriée : bleu lunaire pour le solo de la falaise, lumière ensoleillée pour les « Amen » grandioses. Et surtout, les petits lampions qui signalent les marches, qui se transforment dans la lumière tamisée en tapis de constellations. De salle de concert à cathédrale, de cathédrale à firmament, Pygmalion sculpte la salle pour en faire épouser les courbes aux phrases de Monteverdi.
Alors certes, deux heures de Monteverdi c’est parfois long. Les deux jeunes femmes assises à ma droite n’ont pas tenu et sont parties (en plein milieu d’un chant…). À chacun sa sensibilité. Mais c’est vrai : il y a des longueurs, des moments où l’on décroche : c’est là où, à mon avis, le ballet des chanteurs, les voix se déclarant d’un bout à l’autre de la salle, la mise en scène prennent le relais. C’est finalement comme un road-trip. Il y a des moments très longs, des lignes droites, des paysages qui se ressemblent tous – et soudain, à l’orée d’une forêt, au sommet d’une pente, au détour d’un virage, un paysage, une harmonie se dévoile. Et ça valait le coup d’attendre.
Ce soir là, la musique sacrée a pris pour moi toute son ampleur. La composante héréditaire joue forcément beaucoup : je renoue avec des souvenirs de mon enfance. Et pourtant, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a quelque chose d’autre dans cette musique. Un souffle. Une inspiration divine ? Cela me semble être pourtant bien au-delà de la religion – je ne suis d’ailleurs ni croyant ni baptisé. Il y a du mystique dans la musique sacrée.


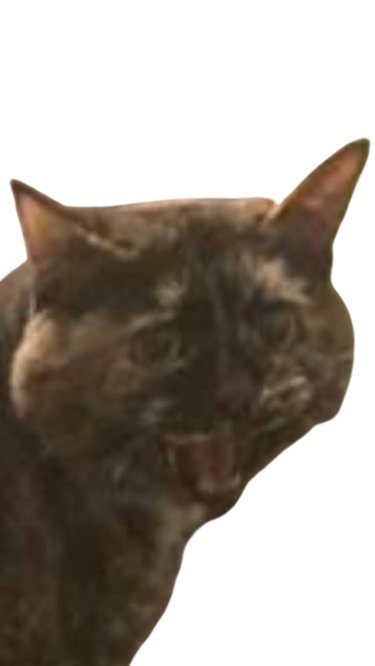
Laisser un commentaire