- Vu le filage du 23 mars à la Comédie-Française
Et encore un. Encore un Racine qu’un metteur en scène renommé se décide à mettre en scène de façon, à mon avis, un peu plate. Guy Cassiers revient à la Comédie-Française après sa mise en scène du roman de Dostoïevski, Les Démons, en 2021. Cette fois, au moins, on ne sera pas perdu dans les méandres romanesques qui se prêtaient assez peu à la scène : Cassiers s’attaque à Bérénice. Mais là encore, il y a un twist qui motive le projet. Pour Les Démons, c’étaient ces trois grands écrans surplombant le plateau, qui permettaient à des acteurs diamétralement opposés dans l’espace de se regarder et de se toucher par la magie des angles de la caméra. Cela m’avait laissé un peu froid : j’y voyais là surtout une démonstration technique sans grande profondeur, un spectaculaire dévitalisé.
Jeux de jumeaux, jeux de vilains
Mais ici, le twist est profondément imbriqué dans la dramaturgie. Cassiers a décidé de faire jouer Antiochus et Titus, les deux amis, les deux amants de Bérénice, par le même acteur (Jérémy Lopez). Seul un long pardessus les différencient : il lui suffit d’enlever le manteau pour changer d’identité. Habilement caché par des jeux de silhouette à travers des panneaux coulissants, les doubles ne se rencontrent pas sous les yeux du public, jusqu’à ce que finalement, Titus tienne son ami – son manteau – dans ses bras pour le supplier d’être le témoin de son amour pour Bérénice ; ou peut-être pour réveiller en lui l’amour passionné de son double Antiochus.
Soudain, Antiochus, ce personnage réputé inutile à l’intrigue, prend tout son sens. Il est le double de Titus. Ils ne font qu’un : ils sont le même homme, cet amant qui ne peut pas supporter son propre amour, qui torture Bérénice (Suliane Brahim) par son indécision. Dès lors, quand Bérénice choisit de partir par amour, le geste est d’autant plus sublime : il dépasse les limites de la scène. Jérémy Lopez n’apparaît plus comme l’un ou l’autre, il apparaît comme un acteur luttant contre ses démons intérieurs. Bérénice-Brahim le quitte, les quitte tous deux et s’émancipe ainsi de leur emprise, de l’emprise de la tragédie et du pouvoir politique. Les confidents sont aussi brillants dans leurs de manipulateurs ou de soutiens attentionnés.
Bouh, Bérénice !
La scénographie n’est pas en reste : le plateau a des airs de manoir japonais, avec ses fines parois coulissantes. De fins piliers lumineux s’éclairent aux sons mystérieux de diapasons quand les personnages entrent et sortent. Au fond, des écrans diffusent des images fragmentées (très kitsch), évocatrices de la Palestine de Bérénice (pas la moindre évocation politique, malheureusement…). L’espace scénique semble hanté. Au centre du plateau, au milieu d’un petit bassin qui rappelle les cours des maisons romaines, trône une statue à la forme indéfinie : buste de femme ? cœur humain ? La forme s’assombrit au fur et à mesure de la pièce, comme si elle capturait les esprits environnants, concentrant toute la tension accumulée. Entre les actes, les écrans défaillent et crépitent au son de basses qui font vibrer les os : on croirait presque à une expérience live d’analog horror. Angoisse plus qu’existentielle, donc.
Mais…
Cela se laisse bien regarder. Les acteurs sont excellents, comme d’habitude. Mais j’avoue en avoir un peu marre de ces mises en scène de Racine qui semblent toutes se ressembler : hommes en longs manteaux sur des chemises de lin aux couleurs beige, marron et pastel ; femmes en longues robes unies ; tons languissants, acteurs très fixes, sans aucun engagement corporel. C’est Braunschweig all over again. Mais en outre, ces anachronismes : les écrans, certes, mais aussi les notifications twitter pour faire circuler les informations dans le dernier acte. Pourquoi ? C’est incongru, ça sort immédiatement le public de la diégèse. C’est un détail, mais assez significatif à mes yeux : comme si Cassiers avait besoin de choquer le public pour montrer qu’il avait apporté sa propre touche à la pièce de Racine.
De fait, le metteur en scène ne semble pas avoir grand chose à dire sur Bérénice. Encore une fois, tout semble tourner autour du twist. Il se saisit du classique de façon ingéniseuse, mais il aurait pu, je pense, tirer bien plus de fils interprétatifs de ce jeu de doubles. Il aurait pu exploiter bien davantage le potentiel émotionnel et politique infini des chefs-d’œuvre. Enfin, ça reste de toute façon du théâtre grand-public. Mais cela devrait être le propre du théâtre de plonger dans le politique. Dommage.


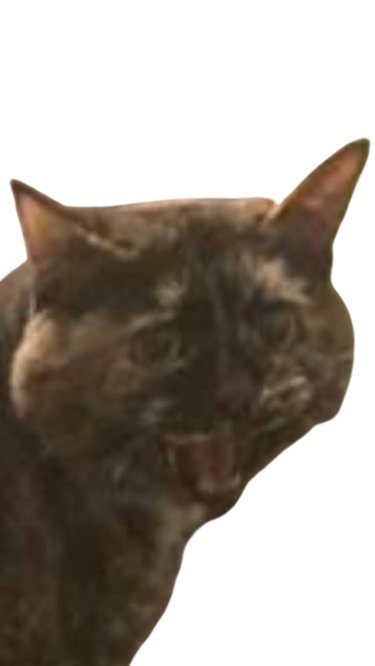
Laisser un commentaire