- vu le 22 octobre au Théâtre du Soleil
Un spectacle bien ficelé, très bien exécuté, largement à la hauteur de ses moyens, avec des actrices – et chanteuses – impressionnantes d’efficacité. Flávia Lorenzi et la compagnie Brutaflor décident de reprendre à leur compte Les Héroïdes, recueil de lettres fictives d’Ovide, où des héroïnes de la mythologie déclarent leur amour aux héros, bien souvent plus célèbres qu’elles. Il faut croire que mes études de lettres classiques ont été lacunaires, puisque je n’en avais jamais entendu parler. On se doute cependant que l’image que le poète renvoie des femmes est moins reluisante que celle de leurs brillants destinataires, lorsqu’on connaît la vision de la femme assez effarante qu’il exprime dans L’Art d’aimer. Les six actrices et leur metteuse en scène revisitent donc son œuvre de manière féministe. Et ça fonctionne.
À noter que l’une des actrices a été ma prof de théâtre pendant deux ans ; c’est d’ailleurs avant tout pour ça que je venais. Mais je vais m’efforcer d’être le moins biaisé possible.
Sur scène, quelques praticables, un ou deux instruments de musique. Un grand écran qui est utilisé avec parcimonie pour créer des effets d’ombres chinoises et d’atmosphères, compensant ainsi le peu de projecteurs. Les actrices arrivent discrètement, et commencent à chanter, a cappella puis accompagnées à la basse, un chant rythmé. Un feu est allumé. Des cornes de minotaure sont exhibées et opposées à une structure de robe qui crée une silhouette de princesse grecque. Des images se forment. Toutes se rejoignent ensuite en ligne, face public : leurs voix mêlées nous parviennent par nappes. Mais on émerge rapidement de cette plongée dans leur imaginaire mythologique.
https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/agenda-2023/les-heroides-2023-2448Télécharger
Une structure par chapitres-performances
On commence à comprendre que chacune des actrices s’est vue attribuer une des grandes figures féminines de la mythologie et développe une proposition scénique d’une dizaine de minutes autour de celle-ci. La première est une sorte de parodie de jeu télévisé qui met en compétition les différentes versions du mythe d’Ariane. Les actrices entrent dans le rôle des différents personnages pour raconter rapidement leur histoire telle qu’elle est contée par tel ou tel auteur ; puis en sortent aussitôt pour commenter. En effet, on a un effet de théâtre dans le théâtre. Les actrices se jouent elles-mêmes en train de jouer et d’interpréter les textes. Elles s’interpellent entre elles par leur vrai nom et s’adressent à nous de manière plus libre que s’il y avait la barrière de la fiction entre la scène et le public.
S’ensuivent les réflexions et propositions scéniques autour de Déjanire, d’Hypsipyle, de Didon ou encore de Médée. Une des séquences est assez surprenamment dédiée à Niki de Saint-Phalle ; qu’importe, on parle après tout plus de femmes et de féminisme que de mythologie. On n’est donc pas surpris, d’autant qu’on comprend assez vite que le spectacle relève en grande partie d’auto-fiction, ou plutôt de fictionnalisation de leurs propres séances de travail. Elles ont dû travailler sur Niki de Saint-Phalle, puis il leur a semblé logique de garder et de valoriser ce travail dans le spectacle. Ç’aurait pu être gênant ailleurs, mais le dispositif d’une pièce en évolution, construction sous les yeux même du spectateur, autorise ce genre de sinuosité dramaturgique qui s’inscrit de toute façon dans l’économie générale de la pièce.
Un rythme soutenu
Cela peut cependant parfois être un peu déconcertant pour le spectateur attentif : les actrices composent des images comiques ou oniriques, qu’elles brisent soudainement pour en faire l’exégèse en revenant à la réalité. Il est alors difficile de s’immerger dans une esthétique continue et unifiée sur le spectacle entier. Celui-ci se présente sous la forme d’une mosaïque qu’on peut avoir un peu de mal à apprécier dans sa globalité. Par exemple, dans la séquence dédiée à Déjanire, un système similaire au simulacre de jeu télévisé est établi. Hercule arrive depuis le public dans une reproduction de cérémonie de remise de prix. Il dérape, et fait une démonstration assez inquiétante de sa masculinité toxique. Un rapprochement avec le traitement accordé aux célébrités d’aujourd’hui accusées de viols et de crimes du même type est vite établi. Soudain, un effet de malaise se crée, et l’on ne sait plus trop si l’on doit rire. Hercule était ridicule et l’on riait de son sexisme flagrant. L’effet de malaise est réussi. Les actrices parviennent à jouer des attentes et de la perception du spectateur. Mais – et c’est là peut-être mon seul regret – les effets ne durent pas, et sont assez vite désamorcés. On peut ainsi se sentir un peu baladés d’un ton à l’autre, du grave au rire, sans avoir eu le temps de bien s’établir dans une situation .
Cela permet néanmoins de garder continuellement l’attention du spectateur, puisqu’on lui donne régulièrement un regard critique sur ce qu’il vient de voir. La preuve : même les enfants répondent aux questions plus ou moins rhétoriques de actrices, restant donc bien investis dans le spectacle.
Pour finir en musique
Et surtout, surtout, quelles performances, notamment vocales, de chacune des actrices ! L’une se révèle chanteuse lyrique, l’autre fait du slam et du clavier ; il y aussi une guitariste, une bassiste, une chanteuse rock… J’ai entendu de tout. Toute la musique ou presque est interprétée en live par les actrices elles-mêmes, et c’était particulièrement impressionnant. Elles chantent mais créent aussi des atmosphères, imitent le vent et les oiseaux. On en aurait voulu plus encore. C’étaient aussi des performances physiques. Tout le plateau est investi : les comédiennes profitent et s’amusent de l’espace. C’était donc assez réjouissant. Elles se réapproprient par le texte, par le corps, par la voix, notre imaginaire commun en redonnant aux figures féminines leur juste place. Certes, il n’y a rien de révolutionnaire esthétiquement. Je ne ressors pas profondément changé ou chamboulé du spectacle. A priori, rien de révolutionnaire politiquement non plus : la relecture féministes de la mythologie n’est pas une idée particulièrement neuve, et je pense qu’au Théâtre du Soleil, le public est majoritairement converti à la cause de toute façon. En somme, cette création ne pousse pas vraiment à la réflexion ou au questionnement. Mais elle reste une puissante démonstration de théâtre féministe.

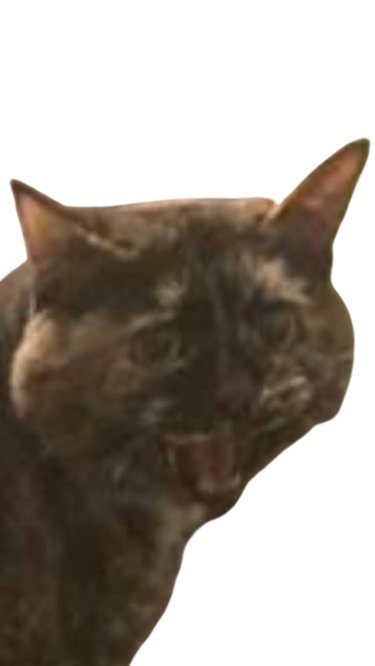
Laisser un commentaire