- vu le 15 janvier 2024 à la Comédie française
Introduction
La représentation à laquelle j’ai assisté était particulière. Il s’agissait de la dernière d’une reprise qui avait lieu depuis novembre. C’est que le spectacle, qui avait été créé en juin 2021, cartonnait toujours autant. C’est donc Le Bourgeois gentilhomme qui amenait, ce soir-là, l’hommage annuel à Molière, à la date anniversaire de son baptême. La représentation était gratuite, et les spectateurs en quête de place formaient une queue qui s’étendait des portes de la Comédie française à celle du Conseil d’État en traversant la place Colette dans son intégralité. Heureusement, l’affreux privilégié que je suis disposait d’une invitation, et a pu honteusement dépasser la longue colonne de pèlerins aux yeux rivés sur leur destination (ou sur leur téléphone).
L’hommage est un moment toujours réjouissant. Chacun des acteurs, dans l’un des derniers costumes qu’il ou elle a endossés, donne une réplique de Molière. Il y a deux ans, c’était à son buste qu’on s’adressait. Cette année, c’était à Claude Mathieu, qui cède sa place de doyenne à Thierry Hancisse pour devenir sociétaire honoraire de la maison, et accéder à un repos bien mérité. L’hommage avait donc ce jour-là la tonalité d’un au-revoir ; les comédiens et comédiennes donnaient chacun et chacune à leur tour une rose blanche à Claude Mathieu. C’était assez touchant.
Mais cela ne prenait place qu’après le spectacle lui-même qui, pendant deux heures vingt, avait chauffé le public : car c’est un petit concentré de bonheur. Il n’y a rien de fondamentalement révolutionnaire ou d’esthétiquement renversant. Je crois avoir utilisé plusieurs fois déjà cette expression. C’est que Le Bourgeois gentilhomme est avant tout un divertissement. Mais au sein du théâtre public, je trouve très belle l’idée que de tels blockbusters puissent être financés par l’État. Que l’argent public nous donne la possibilité d’accéder à un divertissement de qualité, ce que Molière a toujours et d’abord été. Le théâtre public, c’est le terrain de l’avant-garde, de la recherche, de la scène comme un lieu d’avancées humaines, esthétiques et artistiques ; mais c’est aussi le terrain d’un divertissement libre et débridé, qui n’existe que pour qu’acteurs et public puissent exulter, rire et s’oublier dans un imaginaire bien ficelé. L’État nous offre encore un peu la possibilité d’échapper éphémèrement à une vie avilissante au service du gain : profitons-en pendant que cela est encore possible, et sortons au théâtre.
Le Bourgeois est une de ces grosses productions qui n’est donc certainement pas d’avant-garde. Mais les dispositifs extrêmement bien réglés, le jeu aussi burlesque que spectaculaire, la scénographie léchée et l’imaginaire débordant en font une grosse production d’une finesse inégalée. Les choix de direction et de mise en scène traduisent aussi des partis-pris discrets, qui n’empiètent pas sur le texte de Molière, mais qui sont bien existants.
Un monde fascinant
Valérie Lesort et son conjoint Christian Hecq (qui interprète le rôle titre) font une lecture atemporelle de la pièce. Pas de costumes d’époque ni d’habits contemporains comme chez Braunschweig. Il ne s’agit pas de faire de Molière notre contemporain, ni de dire que ses textes ne vieillissent pas. Certes, ses pièces demeurent des réserves infinies de motifs qui permettent des mises en scène toujours renouvelées. Mais le choix des metteurs en scène, ici, est de nous placer dans un monde décalé, une sorte de conte fantastique. Ils parlent eux-même de film de « fantasy » comme influence dans le programme de salle. Il y a un côté fable universelle, mais qui n’a rien d’appuyé. Il n’y a pas de portes ouvertes enfoncées. Lesort et Hecq visent simplement à stimuler notre imaginaire pour nous impressionner.
Pour cela, ils font largement appel à l’enfance, pour reconstituer un rapport simple au théâtre qui passe par l’émerveillement. Hecq dit ainsi :
Pour moi, M. Jourdain n’est pas un contre-emploi, je me sens proche de lui, parce qu’il est habité par des rêves d’enfant, des rêves naïfs ; ce sont des éléments que nous utilisons beaucoup dans nos spectacles, Valérie et moi. En tant que comédien, ma source principale d’inspiration est l’enfance. Les rêves d’enfant sont les plus puissants parce qu’ils ne sont pas encore abîmés par la contrainte de l’éducation, les normes imposées. Ce sont des rêves purs.
Dans ce cadre, on assiste à des marionnettes, des duels à l’épée, de la musique à gogo. On est plongé dans une sorte de fascination semblable à celle que, tout petit, je pouvais avoir à l’écoute du Soldat Rose ou au visionnage de Robin des Bois. On est dans un monde semblable mais décalé, où l’on reconnaît certaines références tout en se laissant entraîner par ce qui nous est étranger. C’est à la fois familier, chaleureux, curieux et captivant. C’est pourquoi les deux metteurs en scènes semblent souligner l’aspect poétique de leur personnage.
- Le rôle de la musique
La musique joue un rôle primordial dans cet univers. À la fois intradiégétique et extradiégétique, elle fait le lien entre le spectateur et les acteurs. Les instrumentistes font partie de la pièce, et font aussi partie du public, puisque lorsque le rideau se lève, ils jouent depuis une loge en corbeille. Comme le rappelle Florence Thomas, archiviste-documentaliste de la Comédie française, le Bourgeois est une comédie-ballet, dont la musique avait originellement été commandée à Lully. Depuis 1670, la partition de la pièce a été remaniée, écartée ou réhabilitée. Les musiciens du spectacle s’inscrivent donc dans une longue tradition. Le choix a été de garder les airs de Lully, mais d’en changer la couleur. On garde le baroque, mais on le déplace dans les Balkans – avec parfois quelques passages qui rappellent le klezmer. Hélicon, trompette, accordéon et saxophone sont ici les stars. Ils contribuent à créer une atmosphère de jeu, en introduisant l’inattendu, la surprise et l’amusement. Ils accompagnent chaque moment phare, chaque scène vedette de la pièce. Ils amènent aussi avec eux une touche d’exotique qui participe à cet univers décalé, à la fois connu, accueillant, et énigmatique. Tout demeure nappé d’une forme de mystère.
Le fait que les instrumentistes restent pendant l’hommage à Molière est un plus. Ils prolongent un peu le rêve dans la réalité. La musique accompagne à la fois les personnages, les acteurs, et le public. Ce sont eux, le vecteur de la célébration. Cette atmosphère de partage et de plaisir commun passe largement par l’accompagnement musical. Ils enchantent réellement ce moment qu’on partage avec le personnel du théâtre, en donnant l’impression que la vie peut aussi être parfois un véritable spectacle.
- Le rôle des décors et des costumes
Mais les décors (Éric Ruf) et les costumes (Vanessa Sannino) ne sont pas en rade. Ils sont aussi un des rouages majeurs de cette machine à émerveillement continu. Vanessa Sannino a exécuté un travail remarquable. Ses pièces vont de l’onirique au loufoque1. Tous les laquais et les maîtres du bourgeois semblent tout droit sortis d’Alice au Pays des merveilles. Mais surtout, ils participent avec la scénographie à créer un monde cohérent, malgré ses éléments fantastiques. On comprend (et à défaut, c’est expliqué dans le programme), que tous les valets sont chauves pour ne pas faire d’ombre à M. Jourdain. Ils ont tous un écusson représentant son visage, comme un roi sur une pièce de monnaie. Il est le seul à briller au milieu d’une maison faite de noir et blanc. Quant à lui, il a modifié sa maison entière pour que les panneaux noirs qui constituent les murs puissent être retournés en révélant leur envers de doré recouvert.
Il ne s’agit pas de métaphores : tout a une raison et contribue à former un univers cohérent et crédible. La fantastique n’est pas qu’un artifice : il est pris au sérieux. C’est peut-être pourquoi Charlie et la Chocolaterie est aussi impressionnant : l’usine de Willy Wonka est absolument invraisemblable et déjantée. Pourtant, le propriétaire explique aux enfants de façon didactique la façon dont la magie lui permet de produire ses délicatesses ; si bien que l’on finit par y croire avec eux. D’une manière ou d’une autre, la magie existe dans ce monde si proche du nôtre. C’est aussi le cas dans cette mise en scène : on adhère à la cohésion du monde qui nous est présenté, ce qui ne fait que renforcer notre émerveillement lorsqu’il se déploie sous nos yeux. Voilà donc une vraie ode à l’imagination. Comparaison Molière-Roald Dahl : check.
https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/le-bourgeois-gentilhomme23-24#Télécharger
Le rire répond toujours à l’appel
Mais que l’harmonie du dispositif ne nous fasse pas oublier la raison première de notre présence : le rire. Le moteur du comique demeure Christian Hecq. Son jeu est aisément identifiable : mimiques, pantomime, vocabulaire du cartoon, réactions outrées, altérations de voies et performances physiques. C’est un grand acteur comique. Mais les éléments fantastiques du monde qu’ils ont construit sont eux aussi au service du comique : cochon servi lors du buffet qui se met à parler, chèvres qui chantent avec les musiciens sur les airs de Lully… et surtout les jeux de marionnettes, qui servent de renfort au moments clefs. Lorsque les personnages se frappent, ils s’envolent ; lorsqu’ils se donnent des coups d’épée, les épées peuvent flotter.
Les metteurs en scène expliquent que l’espace doit être très obscur, au départ, pour permettre l’invisibilisation des manipulations (je n’ai personnellement pas vu l’ombre d’un fil). Mais la noirceur du décor sert aussi le jeu de contraste avec l’opulence dorée de la fin du spectacle. Outre sa couleur, c’est surtout sa forme et son ergonomie qui permettent le comique. Un large espace vide est laissé du nez de scène à la cloison qui sert de mur de fond. Les personnages ont ainsi toute la place qu’il faut pour se courir après ou organiser des défilés de mode. Des tables mobiles peuvent composer autant le podium de mode nécessaire qu’une estrade d’escrime, une table de banquet ou une scène d’opérette. La cloison du fond est quant à elle faite de croisillons. On voit ce qui se passe derrière. Le couloir qu’on aperçoit est l’endroit parfait pour les courses-poursuites à la Scooby-Doo lors de la querelle des maîtres de M. Jourdain. Il sert aussi de tiers-lieu pour que les personnages se cachent ; ou bien de vestibule, pour qu’on les voie arriver. L’architecture ingénieuse d’Éric Ruf est donc le support de jeu parfait.
Toute la pièce est agrémentée de plusieurs véritables performances musicales et chorégraphiques qui correspondent aux différentes scènes vedettes du texte de Molière. La lecture dramaturgique de Lesort et Hecq sert ainsi à tout moment le spectaculaire. Ces performances culminent à l’arrivée de la suite du grand Mamamouchi. Un éléphant bluffant, entre en musique depuis la grande porte de la cloison, en musique. Il fait de bric et de broc, puisqu’encore une fois, chaque élément fantastique doit rester crédible dans cet univers. Il se compose de foulards, d’abats-jours et d’autres éléments disparates. Mais on a les yeux écarquillés devant un tel étalage de savoir-faire technique. S’ensuit une danse qui est aussi l’apothéose comique de la mise en scène : Jourdain, dupé jusqu’au bout, est couronné d’un urinoir. Il danse, enveloppé de quatre rouleaux de papier toilette se déroulant au rythme frénétique de la musique. C’est aussi fascinant qu’hilarant.
En conclusion…
Je ne sais pas si le Bourgeois gentilhomme rejouera. Si c’est le cas, il faut aller le voir, il faut s’accorder ce plaisir. Si ce n’est pas le cas, alors j’espère qu’il sortira en DVD, ou que Pathé rediffusera la captation au cinéma. Je suis d’habitude fermement opposé au film de théâtre. On y perd, je trouve, toute l’intimité, tout le partage si spécifique au théâtre et aux arts de la scène. Mais je ne doute pas que le comique saura ici percer l’écran.
- Pour un aperçu plus détaillé du travail de Vanessa Sannino, son site est assez riche en dessins et en photographies : https://www.vanessasannino.com/le-bourgeois-gentilhomme-comedie-francaise-2021-valerie-lesort-et-christian-hecq-direction ↩︎

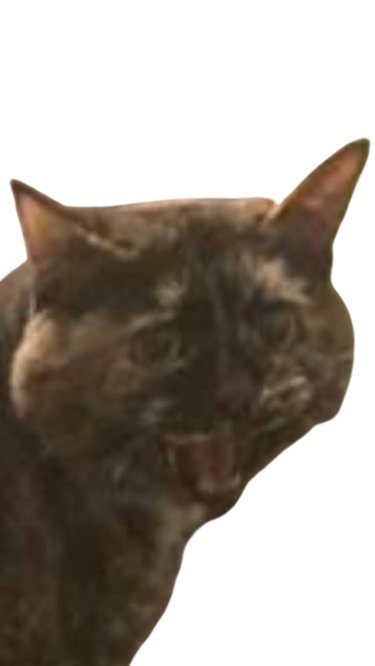
Répondre à Bougy Annuler la réponse